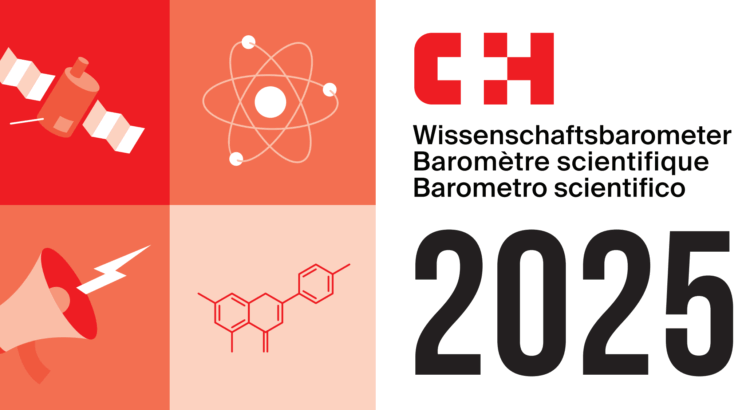La majorité des Suisses soutiennent la recherche scientifique et condamnent les attaques contre la science, selon le Baromètre scientifique 2025 mené par l’Université de Zurich. La plupart des habitants de la Suisse utilisent l’intelligence artificielle, mais beaucoup l’abordent avec prudence.
La population suisse continue de manifester un soutien massif à la science et à la recherche scientifique, d’après les résultats du Baromètre scientifique Suisse 2025 réalisé par l’Université de Zurich. Les chercheurs à l’origine de l’enquête examinent tous les trois ans les attitudes de la population suisse envers la science et la recherche scientifique, et s’intéressent aux sources d’information mobilisées par les citoyennes et citoyens.
Parmi les plus de 1 500 personnes interrogées, plus de la majorité d’entre elles considèrent la recherche scientifique comme nécessaire, approuvent son financement public et estiment que les décisions politiques devraient s’appuyer sur des connaissances scientifiques. Une proportion stable et élevée (60 %) d’entre elles déclarent avoir une grande ou totale confiance dans la science, même si la part des sceptiques a légèrement augmenté ces dernières années.
Une image majoritairement favorable de la science
« Nos résultats montrent que la Suisse repose sur des bases solides en tant que société de l’innovation et du savoir : la majorité de la population suisse soutient fermement la recherche scientifique », explique Mike S. Schäfer, codirecteur du projet et professeur au Département de communication et de recherche sur les médias de l’Université de Zurich. Cela se reflète également dans un autre résultat, ajoute-t-il : « Alors que les personnes interrogées considèrent comme légitime la critique objective de la science, de ses méthodes et de ses bailleurs de fonds, elles rejettent massivement les attaques personnelles, telles que les insultes, les menaces ou les violences envers les chercheuses et chercheurs – c’est un signal important pour le débat public. »
Cependant, au-delà de ces points communs, des différences apparaissent nettement entre certains groupes. Une analyse conjointe des connaissances scientifiques, de l’intérêt, des attitudes et de la confiance révèle l’existence en Suisse de quatre groupes percevant la science et la recherche scientifique de manière différente. Les « scientophiles » affichent une très grande confiance dans la science, tandis que les « intéressés critiques » apprécient la recherche scientifique, mais lui fixent des limites claires. Ces deux groupes représentent ensemble environ un tiers de la population suisse. Environ 48 % des habitants se montrent plus distants et appartiennent aux « soutiens passifs ». Enfin, les « sceptiques » représentent environ 17 % de la population.
La télévision, source d’information clé – les outils d’IA plébiscités par les jeunes
La télévision reste la principale source d’information du grand public sur les thèmes scientifiques, suivie par les journaux et les magazines. Les films et séries gagnent en importance dans ce domaine, tandis que Wikipédia et les sites des autorités continuent de jouer un rôle notable comme sources d’information scientifique. Les plateformes vidéo et les outils d’IA sont particulièrement utilisés par les jeunes, qui les privilégient par rapport à la radio, aux podcasts ou aux services de messagerie. Outre les médias, les interactions personnelles jouent également un rôle : beaucoup discutent de science avec leurs proches ou visitent zoos, musées et expositions.
« Nous observons ici des traces claires de la transition médiatique », souligne Julia Metag, codirectrice du projet et professeure à l’Université de Münster. « Les canaux traditionnels restent pertinents, mais les formats audiovisuels et les ressources numériques – y compris les outils d’IA – exercent une influence marquante sur les jeunes et façonnent leur manière d’entrer en contact avec la science. »
« Globalement, plus de trois quart de la population (78%) souhaitent que les scientifiques les informent sur leurs activités, soulignant l’importance du lien direct entre science et société » souligne Fabienne Crettaz von Roten, membre du Conseil consultatif et professeure à l’Université de Lausanne.
Pour la souveraineté numérique et des modèles d’IA suisses
La majorité des habitants de Suisse utilisent l’intelligence artificielle, et environ un quart y recourt fréquemment. Cette utilisation s’opère avec prudence : près de la moitié des personnes interrogées ne considèrent pas, ou tendent à ne pas considérer, l’IA comme une source fiable d’information sur des sujets scientifiques; à l’inverse, seuls quelques répondants lui accordent une grande confiance. De plus, 71 % souhaitent que la Suisse développe ses propres modèles d’IA afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine.
« Les gens souhaitent disposer d’infrastructures suisses d’IA, tout en demeurant prudents quant à son utilisation comme source d’information », note Niels G. Mede, codirecteur du projet et professeur assistant à l’Université de Wageningen. « Cette combinaison de confiance dans la capacité d’innovation suisse et de scepticisme raisonnable à l’égard des outils d’IA actuels constitue un point de départ important pour une stratégie responsable de l’IA en science et dans la société. »
À propos du projet
Depuis 2016, le projet « Baromètre scientifique Suisse », mené par l’Université de Zurich, examine tous les trois ans les attitudes de la population envers la science et la recherche scientifique et étudie les sources d’information utilisées. Cette année, le projet est codirigé par le Prof. Dr. Mike S. Schäfer (Université de Zurich), la Prof. Dr. Julia Metag (Université de Münster) et le Prof. Dr. Niels G. Mede (Université de Wageningen). Il est financé par l’Université de Zurich, les Académies suisses des sciences, le Conseil des EPF, le Fonds national suisse et la Fondation Gebert Rüf.
Méthodologie
Le Baromètre scientifique 2025 repose sur une enquête représentative par questionnaire (en ligne et sur papier). L’échantillon de population a été constitué avec l’aide de l’Office fédéral de la statistique à partir des données du recensement de la population résidente assimilée linguistiquement âgée de 16 ans et plus. Au total, 1 548 personnes (990 de Suisse alémanique, 317 de Suisse romande et 241 de Suisse italienne) ont été interrogées entre le 13 juin et le 10 juillet 2025. Pour les modules « critiques et attaques contre les chercheurs » et « intelligence artificielle », l’échantillon a été divisé aléatoirement en deux sous-groupes, selon la méthode du split ballot. L’échantillon a été pondéré selon le sexe, l’âge, la région linguistique, le canton, le type de commune et le niveau d’éducation.